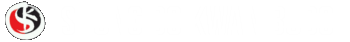Comment les dan sont-ils décernés en Occident ?
Au Japon, après le 3e dan, les critères diffèrent. Parce que l’on entre dans le domaine des arts martiaux, avec d’autres critères que style-kata-combat.
En Occident, depuis les catégories de poids, on a perdu tout complexe : on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, et il n’aurait pas fait sérieux que des dan inférieurs jugent des dan supérieurs. Dans la plupart des nations occidentales, les commissions furent bientôt composées de membres des 4e, 5e et 6e dan, L’auto délivrance de dan supérieurs ressemble à certaines royautés et dictatures, où un général, un maire du palais, se nommèrent eux-mêmes roi ou empereur, parfois en se faisant confirmer par des inférieurs (les barons, pour certains rois de France).
Quelle était la tradition au Japon, dans ce domaine, pour les samouraï et pour les maîtres d’arts martiaux ? Le jeune futur samouraï était habituellement initié par son père samouraï, jusqu’à environ sept ans, âge auquel on lui coupait les cheveux d’une façon particulière, au cours d’une cérémonie émouvante. On lui remettait son premier sabre, tranchant comme un rasoir, puis il était, en général, initié par les maîtres d’arts martiaux de l’uji (clan) dans les diverses disciplines de base : arc, sabre, lances, cheval, nage, combat en corps à corps, etc., comme je l’ai déjà décrit dans les kakuto bugei. Il allait au champ de bataille dès ses quinze ans, parfois plus jeune.
Mais il nous faut être prudent sur les âges historiques japonais : treize ans, pour un japonais, peut correspondre à quatorze ans ou quinze ans pour nous, puisqu’à sa naissance, un bébé japonais est déjà âgé d’un an, et qu’on lui donne un an de plus le premier janvier suivant (et non le jour de son anniversaire), ce qui simplifie d’ailleurs les âges scolaires. Si bien qu’un bébé né le 31 décembre... est âgé de deux ans le 1er janvier.
De même, il nous faut être prudents en ce qui concerne les noms. Les gens du peuple n’avaient pas le droit d’avoir un nom de famille, privilège réservé aux castes supérieures. Un peu comme chez nous au Moyen Âge. Certains Occidentaux, «adoptés» par un maître japonais, portent maintenant un nom japonais à l’ancienne, ce qui nous étonne, mais est parfaitement l’usage.
À partir de quinze ans (âge japonais), le jeune samouraï perdait son nom d’enfant (yomyo), et prenait son nom d’adulte, qu’il changeait parfois plusieurs fois, notamment aux grands tournants de sa vie. Un labyrinthe compliqué pour un Occidental, et même pour un Japonais, car selon la classe, il y a :
• Le nom de famille, ancien et caractéristique des grands clans (kabane ou sei), tels que Taira, Minamoto, Fujiwara etc.
• Le nom de famille, ressemblant au nôtre, souvent lieu de localité (uji ou myoji), tel que Yamamoto («au pied de la montagne»), Matsumura («village des pins»), réservé aux nobles jusqu’en 1870.
• Le nom commun, ressemblant à notre prénom (zokumyo ou tsusbyo), désignant souvent le premier mâle (taro), le deuxième (jiro),le troisième (saburo), etc. ce qui, avec préfixe, donne par exemple Djintaro, Tsunejiro, etc.
• Le vrai nom, assez mystérieux, pour les circonstances solennelles, tels Yoshisada, Masashige.
• Le surnom (azana), qui n’est pas vulgaire, mais au contraire un signe d’élégance.
• Le pseudonyme (go) adopté par la plupart des artistes, y compris artistes martiaux, qu’ils pouvaient léguer à leur disciple (Hokusai, Okyo, Bakin étaient de tels pseudonymes).
• Les pseudonymes de poètes (haimyo ougago) et les noms « artistiques », (goeimyo) des acteurs et des geishas (qui n’étaient pas des prostituées). Celui de Shoto (vagues des cimes de pins ondulant sous le vent), le nom de plume de Gichin Funakoshi, en est un exemple.
• Le nom posthume honorifique de grande classe (okuri na); par exemple, les empereurs (mikado) décédés… portent, après leur mort, des noms qu’ils n’ont jamais portés durant leur vie.
• Le nom posthume ordinaire (homyo ou kaimyo) choisi par le prêtre bouddhiste à la mort du croyant, selon son sexe, âge, rang, secte. À ce propos, on se mariait souvent (encore maintenant) dans un culte, shinto, par exemple, et l’on était enterré parfois dans un autre, bouddhiste, chrétien ou autre.:
• Pour les femmes, on précédait le nom de «O» (honorable, venant du «A» qui précède les noms en chinois), et jadis, les noms féminins nobles, au lieu du préfixe «O» étaient suivis du suffixe «Ko» Par exemple, pour «mademoiselle Fleur», on disait Hana- Ko au lieu de Ô-Hana.
À la fin du Moyen Âge japonais, qui est le début de l’ère Meiji (1870), le peuple s’empressa d’adopter les coutumes «nobles». Et comme il n’y a pas de gotha japonais, il est difficile actuellement, pour un étranger, en se basant sur le nom, de savoir qui est réellement d’origine noble, ou samouraï, ou du peuple, de quelle région et de quelle caste était sa famille. Car au Japon, il y a encore des castes, y compris une caste impure, les bunrakumin. Ils sont trois millions environ, parqués dans des quartiers spéciaux, tellement brimés que certains, doués en karate, sont allés chercher honorabilité et finances à l’étranger.
Historiquement, il est même difficile de s’y retrouver avec les noms de lieux, qui ont changé autant que ceux des personnes. Par exemple, Tokyo fut Yedo, Tokei, Toto. Et Kyoto fut Heiankyo, Miyako, Saikyo. En outre, autrefois, la coutume était de changer de nom à chaque grand changement dans la vie, y compris aux étapes des âges de la naissance à quinze ans, de vingt à quarante ans, de quarante à soixante ans, après soixante ans, etc.
Et les choses se compliquent aussi du fait des adoptions fréquentes d’un disciple favori ou d’un gendre (coutume pour perpétuer son nom si l’on n’avait que des filles). En outre, à soixante ans, on reprenait l’âge de vingt ans. Délicate coutume, qui étonne plus d’un étranger lorsqu’un Japonais tout ridé lui dit approcher de ses... trente ans. L’âge mûr était de vingt à quarante ans.
Quarante ans était l’âge normal auquel on pouvait commencer à enseigner un art martial sans se ridiculiser (habituellement, renshi vers trente ans, kyoshi vers quarante, hanshi vers cinquante ans). Il y eut bien sûr des exceptions, des surdoués hanshi de dixsept ans, et même moins. Rarissimes, bien sûr.
Plus souvent, la tradition était, à la cinquantaine, de transmettre tous ses biens (souvent en usufruit) au fils aîné (coutume de l’inkyo) et de se retirer dans l’ombre. Une loi obligeait les enfants à subvenir (très largement) aux besoins du père. Il devenait alors «gardien de la tradition» (doshi) se consacrait exclusivement aux arts (y compris les arts martiaux dans leurs aspects supérieurs), ainsi qu’à la philosophie.
À ce propos, rappelons que les religions d’Asie, pour des raisons de karma et de réincarnation automatique, sont plus des philosophies pragmatiques, recherche de sagesse, que des religions dogmatiques avec un «Paradis» comme récompense.
C’est pour toutes ces raisons qu’en arts martiaux traditionnels, les âges correspondent souvent aux distinctions : renshi, kyôshi et hanshi, sont plus authentiques que les kyû et les dan, qui furent adoptés à partir des années 1885-1900 pour les budô plus ou moins occidentalisés (judo, kendo, kyûdo), et 1920 pour le karate jutsu. Dan et kyû s’inspirèrent des dix catégories de la classe des samouraïs, cinq inférieures (kyû) et cinq supérieures (dan). Les dan furent dédoublés par la suite, en judo vers les années 1935, et en karate vers les années 1950.
Niveaux en arts martiaux anciens
Titres honorables :
• Shihan, en principe fondateur d’une ryû. Les brevets menkyôkaiden (droit d’enseigner) et okuden (certifie que le porteur a été initié aux techniques externes et «profondes », ésotériques, et aux higi, techniques secrètes).
• Meijin, «grand maître» ; il a, bien sûr, reçu le menkyôkaiden.
• Dô-shi, «gardien de la Voie» d’une ryû; c’était, en général, le patriarche retiré, ou un fils de ce dernier.
• Ô-sensei, «grand professeur», maître du dojo.
• Sensei, «professeur» ayant responsabilité.
Titres de valeur :
• Hanshi, maîtrise interne et externe unifiée.
• Kyôshi, maîtrise interne. Instructeur complet.
• Renshi, maîtrise externe. Assistant. Expert.
• Monjin, disciple d’une ryû ou d’un meijin.
• Nyûmonsha, novice d’une ryû, (qui signait de son sang le keppan).
• Soto daishi, disciple non logé.
• Uchi daishi, disciple à demeure.
• Kage daishi, disciple caché ; il recevait en secret les enseignements supérieurs. Ces distinctions ont été adoptées par certains arts martiaux plus ou moins modernes, à la place des dan, en abaissant souvent l’âge traditionnel. Néanmoins, comme par le passé, elles ne sont délivrées que par le maître (shihan, hanshi, dôshî) qui s’en porte garant. Et il en est responsable. Il y eut des seppuku de maîtres pour mauvais comportement d’un disciple titré. C’est la différence entre élève et disciple. L’idée de délivrer un titre ou des grades à des inconnus, par une commission d’experts n’ayant pas pu juger le disciple sur une tranche de vie passée au dojo, et jugeant seulement sur l’instant, aurait profondément étonné, choqué, ou fait mourir de rire les maîtres du passé.
Suggestion : il n’est pas bon signe d’éviter les passages de grades sous des prétextes divers tels que : «ils sont sans importance», «il n’y avait pas de kyù ni de dan en véritables arts martiaux», «ce sont des grades militaires et je suis antimilitariste», etc. Toute épreuve est bonne. Mais se laisser prendre à leur piège entraîne aussi des problèmes. Le vrai problème est lorsque l’on décide d’enseigner (généralement sans l’aval de son maître). Le problème est plus grand que lorsque l’on reste simple pratiquant.
Car, même en supposant que l’on ait atteint le niveau renshi (parfaite technique physique), il est évident que l’on se bloque pour la technique interne, pour l’unification externe-interne, faute de transmission du maître; et surtout faute d’introduction de ce dernier auprès d’un autre maître supérieur, ce qui est l’usage dans la chaîne de transmission traditionnelle. Si vous quittez votre dojo pour enseigner ou pour toutes autres raisons, faites-le (au moins) avec courtoisie et reconnaissance (petit cadeau et tout), et revenez de temps en temps au dojo de votre maître pour y transpirer un bon coup.
(Résumé tiré des «Chroniques Martiales», Henry Plée, éd. Budo).
«Vous me demandez pourquoi je porte une lanterne cette nuit, alors que je vous ai dit que j ‘avais le don de voir clair dans le noir ? C’est que si, moi, je peux parfaitement voir la nuit... les autres, eux, ne peuvent pas me voir !» (Mulla Nashrudin)
Francisco Campelo